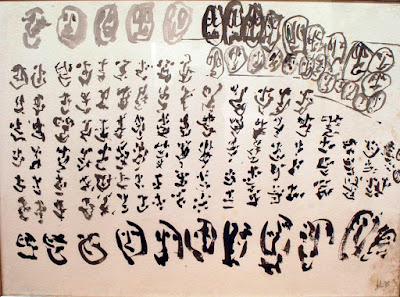La connerie générale bat des records. La Grande Faucheuse moissonne autour de moi. La physiologie déconne. L'insomnie et la dèche s'acharnent sur ce qui reste du pauvre type, qui sait pertinement l'avoir bien cherché et se complait à s'avachir au comble de l'ennui, de la répugnance, de l'aboulie et du cafard mais je ne suis pas du genre à gémir sur mon sort et à pleurnicher ou paniquer. Je passe mon temps à rire comme personne et tout seul de la catastrophe de chaque jour : le grotesque est partout et tout est du plus haut comique pour qui se tient à distance et refuse de participer. À commencer par sa propre existence, dont chaque journée n'est qu'un enchainement de gags irrésistibles, certes cuisants vécus de l'intérieur. J'en fais le moins possible, histoire de m'éviter bien des catastrophes. Je refuse d'aller jouer la moindre comédie, je n'attend rien de rien ni de personne et, aussi incapable de la moindre résolution que d'envisager le moindre espoir, je me contente de fumer, de feuilleter des ouvrages inadmissibles, de me lever à l'heure, bien avant l'aube, où l'élément démocratique sublunaire ronfle encore sur des matelas à crédit, de faire trois siestes par jour pendant que les ronfleurs réveillés et dopés aux antidépresseurs et à l'alcool se démènent au boulot ou s'exténuent à en chercher. Je savoure le luxe de n'être attendu nulle part et de ne contribuer en rien à la perpétuation provisoire de ce monde sur lequel je crache par la fenêtre sans souci que quelqu'un passe en dessous. Sans aucune vergogne, je me laisse dériver cap au pire, en sifflotant faux du Chet Baker ou en me répétant comme un mantra la formule magique de Cioran : "Dans ce monde d'avortons et de poufiasses, il s'agit malgré tout d'être digne". J'ouvre au hasard les Propos sur la racine des légumes, de Hong Zicheng, et je lis en opinant : "Une intégrité rayonnante comme le ciel se forme dans l'obscurité d'une pauvre demeure" ou encore : "Il faut admirer l'homme assez éclairé pour secouer ses manches et quitter la fête quand elle bat son plein. Il peut marcher sans crainte le long d'un précipice." Je tâte et dorlote mes bobos, je cultive ma nostalgie, je retaille plus aigû encore le crayon dont je ne me sers pas. Je démonte, nettoie, graisse et remonte mon arme préférée : ma vieille machine-à-écrire. Je constate que la souffreteuse batterie de mon ordinateur est comme moi : elle se vide de plus en plus vite et se recharge de plus en plus lentement. Je rallume une cigarette. J'espère que ce con de boulanger a fait du bon pain, que le livreur a bien ravitaillé le bureau de tabac, que les éboueurs sont bien passé, que les militaires patrouillent avec des pétoires chargées afin que la chérie circule tranquillement en métro et me revienne entière avec tous ses beaux yeux, ses organes et sa frimousse sublimes, que les fonctionnaires de l'EDF veillent à ce que je puisse à tout moment me chauffer le cul, me percoler le meilleur des cafés, écouter du Henri Mancini ou du Ran Blake, ou brancher ma Stratocaster, surfer d'un œil torve sur la Toile en marmonnant des "Regarde-moi ce con !", mettre la radio et la couper aussitôt en lâchant des "Ta gueule, saloperie", etc… Brèfle… Cette belle vie est épuisante. Elle est réservée aux grands champions du surplace, discipline qui réclame tout le bonhomme, et s'avère pire qu'un marathon puisqu'elle est un marathon sans fin, sans concurrents, sans public, sans voiture-balai ni soigneurs. Je ne la recommande et ne la souhaite à personne. Elle serait fatale à qui n'est pas taillé pour. (Qu'on se contente d'y rêver !).
L. W.-O.